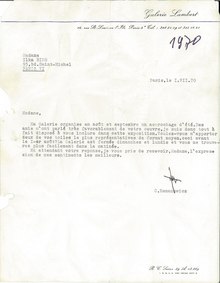art.wikisort.org - Artiste
Ilka Gedő (Budapest, 1921 — 1985) est une peintre et dessinatrice hongroise.
Dans le nom hongrois Gedő Ilka, le nom de famille précède le prénom, mais cet article utilise l’ordre habituel en français Ilka Gedő, où le prénom précède le nom.
| Naissance | Budapest |
|---|---|
| Décès |
(à 64 ans) Budapest |
| Sépulture |
Cimetière israélite de Kozma utca |
| Nationalité |
Hongroise |
| Activités |
Peintre, artiste graphique |
| Conjoint |
Andrew Nicolaus Bíró (en) |
| Enfant |
Bíró Dávid (d) |
| Mouvement |
Expressionnisme |
|---|---|
| Site web |
Son œuvre survit à des décennies de persécution et de répression, d'abord par le régime semi-fasciste des années 1930 et 1940, puis, après un bref intervalle de liberté relative entre 1945 et 1949, par le régime communiste des années 1950 à 1989. Dans la première étape de sa carrière, qui s'est achevée en 1949, elle a réalisé un grand nombre de dessins[alpha 1] qui peuvent être divisés en différentes séries. À partir de 1964, elle a repris ses activités artistiques en créant des peintures à l'huile.
Pour le critique d'art István Hajdu « Ilka Gedő est l'un des maîtres solitaires de l'art hongrois. Elle n'est liée ni à l'avant-garde ni aux tendances traditionnelles. Sa méthode de création incomparable rend impossible toute comparaison avec d'autres artistes. »[1]
Biographie
Jeunesse et formation
Ilka Gedő naît à Budapest le , du mariage de Simon Gedő et Elza Weiszkopf. Son père est professeur au lycée juif, sa mère travaille comme commis. Certains des plus grands écrivains et artistes hongrois de l'époque font partie du cercle d'amis de la famille, et Ilka Gedő est élevée dans une famille où lui sont données toutes les chances de devenir une artiste instruite et sensible. Elle fréquente une école secondaire portant le nom de Új Iskola (hu) (Nouvelle école), qui propose un programme et des méthodes d'enseignement innovants, inspirés notamment par les travaux du psychologue hongrois Nagy László (hu) et du psychologue belge Ovide Decroly[2].

Depuis sa plus tendre enfance, Ilka Gedő n'a de cesse de dessiner, enregistrant ses expériences. La série de dessins de jeunesse, entièrement conservée dans la succession de l'artiste, peut être classée par ordre chronologique, et l'on est ainsi confronté à un journal visuel.
À l'âge de dix-sept ans, elle passe ses vacances dans les collines de Bakony, à l'ouest de Budapest. Elle passe tout son temps à dessiner le paysage. Dans les champs, elle suit les faucheurs, carnet de croquis à la main, afin de voir et de revoir le mouvement récurrent sous le même angle, capturant le rythme avec une grande fluidité et une grande sophistication. Les dessins, aquarelles et dossiers conservés des années 1937-1938 révèlent qu'elle maîtrisait déjà parfaitement la technique du dessin, et ce malgré le fait qu'elle n'avait jamais reçu de cours réguliers jusqu'alors[3],[4].
De la fin des années 1930 au début des années 1940, Ilka Gedő reçoit l'enseignement de trois artistes d'origine juive qui seront tués par les nazis à la fin de la guerre à venir[5]. Lors de sa dernière année d'examen en 1939, Gedő fréquente l'école ouverte de Tibor Gallé (hu) (1896-1944). Le deuxième maître de Gedő est Victor Erdei (1879-1944), peintre et graphiste de style naturaliste-impressionniste et Art nouveau. Le troisième maître de Gedő est le sculpteur István Örkényi Strasser (1911-1944). De ce dernier Gedő apprend la fermeté du modelage sculptural et la représentation de la masse.

Après avoir passé ses examens de fin d'études, Ilka Gedő envisage sérieusement de commencer des études artistiques à Paris, mais la Seconde Guerre mondiale éclate et, en raison des lois juives, elle ne peut plus aller à l'Université hongroise des beaux-arts ; elle n'aurait de toutes façons probablement pas pu la rejoindre, barrée par l'influence croissante des fascistes hongrois, le Parti des Croix fléchées, la privation ouverte du droit de vote des Juifs qui a commencé en 1938 avec les premières lois juives, suivies des deuxièmes et troisièmes en 1939 et 1941[6].
Pendant la guerre, Ilka Gedő gagne sa vie en faisant de la céramique, mais elle ne cesse de créer ses séries graphiques. Elle se rend régulièrement dans la ville de Szentendre, petite ville de province sur le Danube, à une vingtaine de kilomètres de Budapest, qui a servi de refuge à de nombreux artistes dans l'entre-deux-guerres. De 1938 à 1947, Ilka Gedő réalise des dessins au pastel de la ville, reprenant ses formes et ses couleurs directement de la nature. Les couleurs rouge, jaune vif, marron foncé, bleu et vert atteignent une grande intensité de coloration.
Jusqu'au début des années 1940, avec d'autres jeunes artistes, Ilka Gedő visite également l'atelier de Gyula Pap (de) (1899-1982), ancien disciple de Johannes Itten et professeur au Bauhaus[7].
En 1942, Ilka Gedő participe à l'exposition organisée par le Groupe des artistes socialistes intitulée « La liberté et le peuple », qui se tient au Centre de l'Union des travailleurs de la métallurgie[8].
Pendant ces années, jusqu'en 1944, Gedő fait des études intimes de la vie familiale, principalement au crayon. Elle commence une série d'autoportraits qui se poursuivra jusqu'à la fin de la première étape de sa carrière artistique, en 1949.
Dessins réalisés dans le ghetto de Budapest

Le , huit divisions allemandes envahissent la Hongrie. c'est le début de la persécution des juifs hongrois. À une vitesse inégalée, presque tous les juifs hongrois sont déportés dans des camps de concentration en Pologne, où la plupart d'entre eux sont tués[alpha 2].
Malgré les protestations des chefs religieux et les tentatives hésitantes de Miklós Horthy de mettre fin aux déportations, à l'été 1944, environ 200 000 Juifs sont rassemblés dans le ghetto de Budapest et dans des maisons spécialement désignées. Après la tentative infructueuse de Horthy d'emmener la Hongrie en guerre, le parti des Croix fléchées procède à une prise de contrôle militaire le . Dans le ghetto, la pire période commence, mais par chance, Ilka Gedő parvient à échapper à la déportation et à survivre.
Dans le ghetto, Ilka Gedő passe la plupart de son temps à lire et à dessiner en enregistrant son environnement, ses compagnons, les personnes âgées et les enfants. Ces dessins sont des documents inestimables, mais ce sont aussi des allégories de l'humiliation humaine et de l'absence de défense. Dans l'un de ses autoportraits, elle présente une vue frontale d'elle-même, montrant une personne qui a perdu le contrôle de son propre destin[4]. Elle n'a plus d'âge, et presque plus de sexe.
Sur le dernier dessin, on peut voir l'autoportrait de l'artiste avec une planche à dessin. Les yeux semblent fixer le néant. L'ego cherche un soutien dans son propre moi.[Quoi ?]
- Dessins du ghetto
- Fille inclinée, 1944 (Yad Vashem, Jérusalem).
- Autoportrait dans le ghetto de Budapest, 1944 (Galerie nationale hongroise, Budapest).
- Autoportrait dans le ghetto de Budapest, 1944 (Yad Vashem, Jérusalem).
- Autoportrait dans le ghetto de Budapest, 1944 (Musée et archives juifs hongrois (hu), Budapest).
Après-guerre (1945-1949)
Dessins d'autoportraits (1945-1949)
La veille du nouvel an 1945, Ilka Gedő rencontre Endre Bíró, qui a étudié la chimie à l'Université de Szeged et qui, après la guerre, a commencé à travailler pour un institut de recherche dirigé par le scientifique hongrois Albert Szent-Györgyi, lauréat du prix Nobel. Travaillant dans un langage strictement figuratif, l'artiste a besoin de modèles et, en plus de sa famille et de ses amis, Gedő trouve en elle le modèle le plus pratique.
Ilka Gedő crée des autoportraits qui, par leur honnêteté et leur exploration de soi, attirent l'attention du spectateur. Ces œuvres sont dessinées de manière à évoquer à la fois une réalité physique directe et une sensibilité émotionnelle. Cependant, des doutes s'insinuent dans ses efforts pour donner une représentation fidèle et précise de la réalité : le modelé traditionnel et composé qui lui est si caractéristique est progressivement remplacé par un style expressif, éruptif et tendu.
Les dessins de la série d'autoportraits Fillér utca touchent le spectateur par leur cruelle honnêteté et leur authenticité puissante.
- Autoportrait de 1948 (Galerie nationale hongroise, Budapest).
- Autoportrait de 1948 (Galerie nationale hongroise, Budapest).
- Autoportrait de 1948 (Galerie nationale hongroise, Budapest).
- Autoportrait de 1948 (Herzog Anton Ulrich Museum, Braunschweig).
- Autoportrait mélancolique, 1946-1947 (MoMA, New York).
Dessin de l'usine Ganz (1947-1948)
Constamment à la recherche de nouveaux sujets, Gedő trouve dans l'usine de machines Ganz, près de chez elle dans la rue Fillér, un environnement riche et visuellement animé pour dessiner. Ilka Gedő obtient l'autorisation de visiter l'usine avec la recommandation du Syndicat libre des artistes[10].
Comme dans ses autoportraits de la même période, ses dessins et pastels de l'usine Ganz, qui montrent un certain nombre de sujets récurrents, sont des esquisses rapides d'expériences momentanées qui révèlent une concentration spirituelle intense et une puissance expressive. Des lignes nerveuses ondulantes reflètent les impressions de l'artiste sur le travail industriel. La décision d'Ika Gedő de dessiner dans une usine n'était pas motivée par des raisons politiques, et il n'y a aucune trace d'idéalisation dans ces dessins. Des vues panoramiques dramatiques de vastes espaces intérieurs alternent avec des études compatissantes de travailleurs épuisés. Les dessins de l'usine Ganz réalisés par Ilka Gedő sont réalistes, mais surtout expressifs et émouvants. Dans ces œuvres, l'espace et les grandes formes sont présentés comme une nouveauté. Parmi les plans et les blocs, l'homme est réduit à une figure schématique. Les objets qui apparaissent dans l'espace semblent dévorer les figures.
- Dessin de 1948 (British Museum, Londres).
- Dessin de 1948 (British Museum, Londres).
- Dessin de 1948 (Albertina, Vienne).
- Dessin de 1949 (MoMA, New York)
- Dessin de 1949 (Galerie nationale hongroise, Budapest).
- Dessin de 1949 (Galerie nationale hongroise, Budapest).
Série de la table (1949)

Le sujet de ces dessins, un petit tableau toujours visible, est prosaïque, il est toujours à portée de main. Les lignes de ces dessins ne sont jamais le contour de la fermeture d'une zone : elles bougent toujours, libérant ainsi des énergies mystérieuses.
Période du silence créatif (1949-1965)
Hormis sa famille et quelques amis, personne n'a vu les dessins de Gedő au moment où ils ont été réalisés. Durant cette période de 1945 à 1949, elle a commencé à utiliser l'huile en plus du pastel, mais Gedő, dans un accès de dépression et ne voyant aucun moyen de sortir des dilemmes qu'elle connaissait, a détruit la plupart des peintures à l'huile produites durant ces années.
Après une période de liberté remarquable entre 1945 et 1948, le début de la dictature communiste a eu une influence négative sur la vie d'Ilka Gedő, étant l'une des raisons pour lesquelles elle a abandonné ses activités artistiques pendant seize ans.
En 1949, Ilka Gedő a cessé de peindre et de dessiner. Son abandon volontaire a duré jusqu'en 1965[4]. Pendant ces années, à part quelques croquis en couleur, elle ne touche pas à un crayon ni à un pinceau, refusant de le faire même en jouant avec ses enfants. Il y avait trois raisons pour arrêter le travail artistique. La première était le début de la dictature communiste, la deuxième le manque de reconnaissance accordée à l'art d'Ilka Gedő (les amis de Gedő avaient une attitude hostile à tout ce qui était figuratif ou représentatif, la non-figuration étant adoptée comme moyen d'expression politique) et la troisième était qu'Ilka Gedő reconnaissait qu'elle ne pouvait rester fidèle à son talent qu'en arrêtant de créer de l'art. « Arrivée à un point où la seule voie qui lui était ouverte était celle de la planification stérile ou de la prolifération des imitateurs, elle s'est détournée et s'est tue, car c'était la seule façon pour elle de rester fidèle à elle-même et au monde de ses dessins antérieurs »[11].

Lorsque Ilka Gedő a cessé de faire de l'art, elle n'a pas complètement abandonné la possibilité de reprendre. Elle a poursuivi des études approfondies en histoire de l'art. Elle a beaucoup lu sur la théorie des couleurs, en particulier le Traité des couleurs de Goethe, en traduisant de longs passages de cette œuvre. Sans ces études, le monde des couleurs de la deuxième période artistique n'aurait pas été possible.
Au milieu des années 1960, l'artiste a mis presque tous les dessins de la période précédente dans des passe-partout et elle les a également sélectionnés dans des dossiers en fonction des thèmes. Cette activité a duré de nombreuses années. La première exposition individuelle de l'artiste a été une exposition en atelier ouverte le qui montrait une sélection de dessins réalisés entre 1945 et 1948.
À partir du début des années 1960, l'emprise du parti communiste sur la société s'est quelque peu relâchée, mais l'isolement d'Ilka Gedő s'est poursuivi. La situation d'Ilka Gedő a été aggravée par le fait que beaucoup de ses amis, contrairement à elle, ont fait leurs compromis avec le régime, tandis que les artistes talentueux de la jeune génération ont simplement choisi de ne pas participer au système officiel de politique artistique et ont trouvé une reconnaissance à l'Ouest. Elle a finalement eu sa première exposition publique en 1980, à l'âge de cinquante-neuf ans.
Tableaux et dernières années

Dans les années 1960, Ilka Gedő a commencé à peindre à l'huile. Elle a fait des peintures « en deux temps ». Elle a d'abord fait un croquis de sa composition, préparé une maquette et écrit le nom des couleurs appropriées dans les différents champs. Elle a préparé une collection d'échantillons de couleurs et écrit où les couleurs devaient aller par la suite. Elle n'a jamais improvisé sur ses tableaux, mais a plutôt agrandi le plan original. Sur ses tableaux, la force des couleurs froides et chaudes semble être égale. Elle a créé ses peintures lentement, en consignant les étapes du processus créatif dans des journaux intimes afin de pouvoir retracer la réalisation de tous les tableaux[12].
- Clôture du Jardin du Luxembourg, 1979-1985, Huile sur papier couché sur toile, 64 x 49 cm.
- Magasin de Masques, 1980, huile sur papier couché sur toile, 71 x 50 cm, Galerie nationale de Hongrie
Les entrées du journal intime enregistrent toutes les spéculations de l'artiste en rapport avec la réalisation du tableau. Lorsqu'elle mettait un tableau de côté, elle rangeait le journal intime correspondant et continuait à travailler sur un autre tableau. Avant de reprendre le travail sur un tableau, elle lisait toujours les notes de son journal précédent.
Sa méthode de création suit l'appel des instincts mais n'oublie pas la discipline de l'intellect. « Les critiques d'art n'ont pas tardé à souligner les preuves de sa nostalgie de l'Art nouveau et du Jugendstil. Cependant, la véritable nostalgie de Gedő est celle d'une mythologie perdue, et en cela elle est semblable à ses prédécesseurs de la fin de siècle. Elle a trouvé cette mythologie, bien que personnelle, dans l'art, qui est capable d'évoquer et de chérir les souvenirs d'un monde en voie de disparition. »[13]

L'historien de l'art hongrois László Beke évalue son art en 1980 : « Je crois qu'il est totalement inutile d'établir un parallèle entre votre art et les tendances "contemporaines", car votre art aurait pu naître à n'importe quel moment entre 1860 et 2000. Il tire ses inspirations non pas de "l'extérieur", mais de "l'intérieur", et sa cohérence et son authenticité découlent de la relation que cet art entretient avec son créateur - ce qui ne peut échapper à l'attention d'aucun des spectateurs de ces œuvres. »[14]
Ilka Gedő meurt le à l'âge de 64 ans, quelques mois avant sa découverte à l'étranger. C'est à Glasgow qu'elle est ainsi découverte, à l'occasion d'une exposition de ses peintures et dessins à la Compass Gallery en 1985[15],[16],[17],[18],[19].
Au tournant des années 1989-1990, une deuxième exposition rétrospective est organisée au Third Eye Centre (en) de Glasgow[20].
Expositions individuelles et rétrospectives
- 1965 : Exposition Sudio
- 1980 : Gedő Ilka festőművész kiállítása (Exposition d'Ilka Gedő), Musée du roi Saint-Étienne Székesfehérvár, Hongrie
- 1982 : Ilka Gedő, exposition de chambre du Palais des Arts de Budapest au lieu d'exposition de Dorottya utca
- 1985 : Ilka Gedő (1921-1985), Galerie de la Colonie d'art de Szentendre
- 1985 : Ilka Gedő (1921-1985) Retrospective Memorial Exhibition of Drawings and Paintings, Compass Gallery, Glasgow
- 1987 : Ilka Gedő (1921-1985), Palais des Arts, Budapest
- 1989 : Gedő Ilka festőművész rajzai (Les dessins d'Ilka Gedő), le musée de Szombathely, Hongrie
- 1989 : Ilka Gedő : Peintures, Pastels, Dessins, 1932-1985, Third Eye Centre, Glasgow (1989)[21]
- 1994 : Ilka Gedő (1921-1985), Galerie Janos Gat, New York
- 1995 : Ilka Gedő (1921-1985) Dessins et pastels, Shepherd Gallery, New York
- 2001 : Gedő Ilka rajzai 1948-1949-ből (Dessins d'Ilka Gedő des années, 1948-1949), Galerie municipale d'images et le Kiscelli Múzeum
- 2003 : Ilka Gedő, Galerie de la Banque Raiffeisen, Budapest
- 2004-2005 : Gedő Ilka (1921-1985) festőművész kiállítása (Exposition commémorative de Ilka Gedő /1921-1985/), Galerie nationale, Budapest, Hongrie
- 2006 : Könnye kovászba hull--Gedő Ilka (1921-1985) kiállítása ("Pleurez des larmes amères dans la pâte" Exposition d'Ilka Gedő /1921-1985/), Collegium Hungaricum, Berlin
- 2013 : Ilka Gedő, le lobby du Théâtre national hongrois à Budapest
- 2021 : „…Half Picture, Half Veil…” Works on Paper by Ilka Gedő (1921-1985), ( "...Moitié tableau, moitié voile..." Œuvres sur papier d'Ilka Gedő (1921-1985/), Musée des beaux-arts - Galerie nationale hongroise, Budapest, 26 mai - 26 septembre 2021
Expositions de groupe (une sélection)
- 1940 : Az OMIKE második kiállítása (Deuxième exposition d'OMIKE, l'Association éducative juive hongroise), Musée juif, Budapest
- 1943 Az OMIKE ötödik kiállítása (cinquième exposition d'OMIKE, l'Association éducative juive hongroise), Musée juif, Budapest
- 1942 : Szabadság és a nép (La liberté et le peuple), siège du syndicat des métallurgistes, Budapest
- 1945 : A Szociáldemokrata Párt Képzőművészeinek Társasága és meghívott művészek kiállítása (L'exposition de la Société des artistes du Parti social-démocrate et des artistes invités), Musée Ernst, Budapest
- 1947 : Un Magyar Képzőművészek Szabad Szervezete II. Szabad Nemzeti Kiállítása (Deuxième exposition nationale libre de l'Organisation libre des artistes hongrois), Galerie municipale de Budapest
- 1964 : Szabadság és a nép, 1934-1944 (Le groupe des artistes socialistes, 1934-1944), Galerie nationale, Budapest, Hongrie, exposition commémorative
- 1970 : Pendant son séjour à Paris en 1969-1970, elle participe à l'exposition collective de la Galerie Lambert avec deux peintures à l'huile[22].
- 1995 : Culture et continuité : The Jewish Journey, Musée juif, New York
- 1996 : De Mednyánszky à Gedő-A Survey of Hungarian Art, Janos Gat Gallery
- 1995 : Áldozatok és gyilkosok/Gedő Ilka gettó-rajzai és Román György háborús bűnösök népbírósági tárgyalásán készült rajzai/ Victimes et auteurs (Ilka Gedő's Ghetto Drawings and György Román's Drawings at the War Criminal People's Court Trials), Hungarian Jewish Museum, Budapest
- 1996 : Victimes et auteurs /Ilka Gedő's Ghetto Drawings and György Román's Drawings at the War Criminal Trials, Yad Vashem Art Museum, Jerusalem
- 1997-1998 : Diaszpóra és művészet (Diaspora et art), Musée juif hongrois, Budapest
- 1998 : A Levendel-gyűjtemény (La collection Levendel), Musée municipal de Szentendre
- 1999 : Voix d'ici et d'ailleurs (nouvelles acquisitions dans les départements des estampes et des dessins), Musée d'Israël, Jérusalem
- 2000 : Directions, saison d'automne, Janos Gat Galley, New York
- 2002 : 20. századi magyar alternatív műhelyiskolák (Écoles-ateliers hongroises alternatives du XXe siècle), l'exposition conjointe des musées Lajos Kassák et Viktor Vasarely
- 2003 : A zsidó nő (La femme juive), Musée juif hongrois, Budapest
- 2003 : Peintures européennes du XIXe siècle, dessins et sculptures, Shepherd Gallery, New York
- 2003 : Das Recht des Bildes : Jüdische Perspektiven in der modernen Kunst (Le droit à l'image : les perspectives juives dans l'art moderne), Musée de Bochum
- 2004 : Az elfelejtett holocauszt (L'Holocauste oublié), Palais des Arts, Budapest
- 2005 : Der Holocaust in der bildenden Kunst in Ungarn (L'Holocauste dans les Beaux-Arts en Hongrie), Collegium Hungaricum, Berlin
- 2014 : A Dada és szürrealizmus. Magritte, Duchamp, Man Ray, Miró, Dalí. Válogatás a jeruzsálemi Izrael múzeum gyűjteményéből (Dada et le surréalisme. Magritte, Duchamp, Man Ray, Miró, Dalí. Une sélection des collections du Musée d'Israël), exposition conjointe du Musée d'Israël et de la Galerie nationale, Budapest, Hongrie, Budapest
- 2016 : Kunst aus dem Holocaust, Deutsches Historisches Museum, Berlin
- 2019 : In bester Gesellschaft--Ausgewählte Neuerwerbungen des Berliner Kupferstichkabinetts, 2009-2019 (Dans la meilleure société--Élues nouvelles acquisitions du Berlin Kupferstichkabinett, 2009-2019), Kupferstichkabinett (Musée des estampes et des dessins), Berlin
Travaux dans les collections publiques
- La Galerie nationale hongroise, Budapest
- Le Musée juif hongrois, Budapest
- Le musée du roi Saint-Étienne, Székesfehérvár, Hongrie
- Le musée d'art Yad Vashem, Jérusalem
- Le Musée d'Israël, Jérusalem
- Le British Museum, département des estampes et des dessins
- Le Museum Kunst Palast, Düsseldorf, département des estampes et des dessins
- Le Musée juif, New York
- Le Kupferstichkabinett (Musée des estampes et des dessins), Berlin
- Galerie d'art Albright-Knox, Buffalo, New York, États-Unis
- Le Musée des Beaux-Arts, Houston, Texas, États-Unis
- L'Albertina, Vienne
- Le Metropolitan Museum of Art, département d'art moderne et contemporain, New York
- Le musée du duc Anton Ulrich, Braunschweig, Allemagne
- Le musée des beaux-arts de Cleveland
- MoMA, Département des dessins et estampes, New York
- Städel Museum, Frankfurt am Main
Notes et références
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de la page de Wikipédia en anglais intitulée « Ilka Gedő » (voir la liste des auteurs).
- Notes
- Sur la base d'un catalogue d'œuvres numérisées, le nombre de dessins d'Ilka Gedő dans les dossiers dépasse les trois mille unités, et le nombre de dessins de jeunesse est d'environ 1700. Le nombre de dessins produits entre 1944 et 1949 est de 740, tandis que les collections publiques comptent 355 dessins (Galerie nationale hongroise : 77 ; British Museum : 15 ; Musée d'Israël : 6 ; Musée juif hongrois : 12 ; Musée juif de New York : 3 ; Musée d'art Yad Vashem : 144 ; Berlin Kupferstichkabinett : 8 ; Museum Kunstpalast, Düsseldorf : 8 ; Albertina, Vienne : 15, Musée des beaux-arts, Houston (MFAH) : 10 ; Albright-Knox Art Gallery, Buffalo : 3 ; Metropolitan Museum, New York : 3 ; Herzog Anton Ulrich Museum, Braunschweig (Haum), Braunschweig, Allemagne : 21 ; Cleveland Museum of Art : 3 ; MoMA, New York : 7; Städel Museum, Frankfurt 20 dessins).
- La communauté juive hongroise perd 564 500 vies pendant la guerre, dont 63 000 avant l'occupation allemande[9].
- Références
- (en) István Hajdu, « Half Picture, Half Veil - the Art of Ilka Gedő : Œuvre Catalogue and Documents », dans István Hajdu, Dávid Bíró, The Art of Ilka Gedő (1921-1985), Budapest, Gondolat Kiadó, , p. 6
- Új Iskola, la Nouvelle Ecole était l'une des écoles de réforme les plus connues de Hongrie qui mettait en pratique les aspirations de réforme de la pédagogie de réforme qui se développait en Hongrie au début du siècle
- (en) Dávid Bíró, "Ilka Gedő – The Painter and Her Work (A Background Report), MEK (Bibliothèque électronique hongroise de la Bibliothèque nationale de Hongrie), Budapest, 2014. pp. 20-21
- Katalin Gellér, « Gedő, Ilka [Budapest 1921 - id. 1985] », dans Béatrice Didier, Antoinette Fouque et Mireille Calle-Gruber (dir.), Dictionnaire universel des créatrices, Paris, Éditions Des femmes, (ISBN 978-2-7210-0631-8), p. 1712.
- (en) Júlia Szabó, « Ilka Gedő’s Artistic Activities » In: Péter György, Gábor Pataki, Júlia Szabó, István F. Mészáros, The Art of Ilka Gedő (1921-1985), Új Művészet Alapítvány, Budapest, 1997 (ISBN 963-7792-21-X) (ISSN 1219-4913), p. 48-49.
- (en) « Anti-Jewish Laws in Hungary », sur le site de l'United States Holocaust Memorial Museum (USHMM)
- (hu) Nóra Aradi (dir.), Magyar művészet (1919-1945) [Art hongrois (1919-1945)], Volume I, Budapest : Akadémiai Kiadó, p. 398.
- (hu) Nóra Aradi (dir.), Szabadság és a nép (A Szocialista Képzőművészek Csoportjának dokumentumai) [Liberté et le peuple : documents du Groupe des artistes socialistes], Budapest : Corvina Kiadó, 1981, p. 318, p. 287.
- Source de ces chiffres : (en) Encyclopaedia of the Holocaust, McMillan Publishing House, 1990, Vol. II, p. 702.
- (en) Elisabeth Kashey (dir.), Ilka Gedő (1921–1985) Drawings and Pastels, exhibition catalogue, New York : Shepherd Gallery, 1995 (OCLC 313759285), p. 19.
- (hu) „Színes könyv Gedő Ilkának” (Un album haut en couleur pour Ilka Gedő) Holmi (décembre 2003, pp. 1629-1630) La traduction anglaise de cette étude intitulée "In the Rose Garden (Ilka Gedő (1921-1985)- A Retrospective at the Hungarian National Gallery 18 November 2003-31 March 2004/ István Hajdu & Dávid Bíró : The Art of Ilka Gedő, Budapest, Gondolat 2003, 256 pp." a été publiée dans The Hungarian Quarterly, Vol. XLV, No. 175, Autumn 2004, pp. 23-33, avec 12 illustrations en couleur (une sur la couverture du magazine) et 5 illustrations en noir et blanc.
- (en) István Hajdu, Dávid Bíró, The Art of Ilka Gedő (1921-1985) : Oeuvre Catalogue and Documents, Budapest : Gondolat Kiadó, 2003, p. 254.
- (en) Christopher Carrel, Contemporary Visual Art in Hungary: Eighteen Artists (cat. exp.), Third Eye Centre in association with the King Stephen Museum, Glasgow, 1985 (ISBN 0906474507), p. 42.
- La lettre est conservée dans la succession du manuscrit de l'artiste.
- (en) Clare Henry, « Hungarian Arts is Glasgow », Studio International, Volume 199, No. 1012, 1986, p. 56-59.
- (en) William Packer, « Hungarian Arts in Glasgow », The Financial Times, 8 octobre 1985, p. 16.
- (en) John Russel Taylor, « Brilliant Exponent of an Outdated Style », The Times, 29 octobre 1985, p. 15.
- (en) Michael Shepherd, « Hungarian Temperament », Sunday Telegraph, 27 octobre 1985, p. 14.
- (en) Clare Henry, « Chance to Gain a Unique Perspective », Glasgow Herald, 1er octobre 1985, p. 12.
- (en) « Ilka Gedő: Paintings, Pastels, Drawings (1932-1985) », sur cca-glasgow.com (consulté le ).
- « 1989 - 1980 »
-
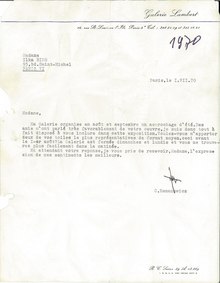
Lettre de la Galerie Lambert, 1er juillet 1970
Annexes
Bibliographie
- Catalogues d'exposition
- Gedő Ilka rajzai és festményei (Dessins et peintures d'Ilka Gedő) catalogue de l'exposition, Székesfehérvár, Musée du Roi Saint-Étienne, Székesfehérvár, Hongrie, 1980, éd. par : Júlia Szabó
- Gedő Ilka, (Ilka Gedő), Budapest, Galerie d'exposition de la rue Dorottya du Palais des Arts, 1982, éd. par : Ibolya Ury
- Gedő Ilka (1921-1985) festőművész kiállítása, (L'exposition du peintre Ilka Gedő /1921-1985/) Szentendre, Galerie de la Colonie des arts de Szentendre, 1985, éd. par : András Mucsi
- Gedő Ilka (1921-1985), Budapest, Palais des Expositions, Budapest, 1987, éd. par : Katalin Néray
- Gedő Ilka festőművész rajzai a Szombathelyi Képtárban (Les dessins d'Ilka Gedő au Musée Szombathely), Szombathely, Szombathelyi Képtár, 1989, ed. by : Zoltán Gálig
- Áldozatok és gyilkosok/ Gedő Ilka gettó-rajzai és Román György háborús bűnösök népbírósági tárgyalásain készült rajzai / Victimes et auteurs - Ilka Gedő's Dessins dans le ghetto de Budapest et les dessins de György Román au procès d'un criminel de guerre), Budapest, Magyar Zsidó Múzeum, 1995 és Jeruzsálem, Yad Vashem Art Museum 1996, ed. par : Anita Semjén
- Ilka Gedő (1921-1985) Drawings and Pastels, catalogue d'exposition, New York, Shepherd Gallery, 21 East 84th Street, 1995, éd. par : Elizabeth Kashey
- Directions (œuvres de Julian Beck, Herbert Brown, István Farkas, Ilka Gedő, Lajos Gulácsy, Knox Martin, György Roman), exposition d'automne 2000, Janos Gat Gallery, 1100 Madison Avenue, New York, N.Y. 10028,
- Gedő Ilka festőművész kiállítása, (L'exposition de Ilka Gedő), Budapest, Hungarian National Gallery, 2004, ed. by : Marianna Kolozsváry
- „…Half Picture, Half Veil…” Works on Paper by Ilka Gedő (1921-1985) („...Moitié tableau, moitié voile..." Œuvres sur papier d'Ilka Gedő /1921-1985/), Musée des beaux-arts - Galerie nationale hongroise, Budapest, 26 mai - 26 septembre 2021, par Marianna Kolozsváry, András Rényi
Catalogues des expositions de groupe
- Reform, alternatív és progresszív rajziskolák (1896-1944), (Réforme, écoles alternatives et progressives Darwing), Budapest, Université Moholy-Nagy d'art et de design, 2003
- István Hajdu: "The Work of Ilka Gedő" (L'œuvre de Ilka Gedő), In: La Juive. Exposition au Musée juif et aux archives de Hongrie 25 avril - 2 septembre 1992, pp. 85-106
- Hans Günter Golinski és Sepp-Hiekisch Pickard (Ed): Das Recht des Bildes (Le droit à l'image') , Bochum, 2003, un dessin à la page 21 et des informations biographiques
- Eliad Moreh-Rosenberg Walter Schmerling (Eds.): Kunst aus dem Holokaust, (L'art de la Shoah), Cologne, Wienand Verlag, 2016 ; il y a trois dessins dans le volume par Ilka Gedő
- Thomas Döring & Jochen Luckhardt : Meisterzeichnungen aus dem Braunschweiger Kupferstichkabinett", (Dessins maîtres du Brunswick Musée des estampes et des dessins), Dresden, Sandstein Verlag, 2017 ; il y a un dessin d'Ilka Gedő à la page 18
- In bester Gesellschaft Ausgewählte Erwerbungen des Berliner Kupferstichkabinetts 2009-201, (Dans le meilleur de l'entreprise Acquisitions sélectionnées du Kupferstichkabinett de Berlin 2009-2019), publié par Andreas Schalhorn, Staatliche Museen zu Berlin-Preußischer Kulturbesitz, Berlin, 2019 (Un dessin d'Ilka Gedő à la page 52).} .
Monographies
- Gedő Ilka művészete (1921-1985) György Péter-Pataki Gábor, Szabó Júlia és Mészáros F. István tanulmányai /The Art of Ilka Gedő (1921-1985) Études de Péter György-Gábor Pataki, Júlia Szabó et F. István Mészáros/ Budapest, Új Művészet Kiadó, 1997
- Hajdu István-Bíró Dávid: Gedő Ilka művészete, oeuvre katalógus és dokumentumok, Gondolat Kiadó, Budapest, 2003
- István Hajdu-Dávid Bíró : The Art of Ilka Gedő, Oeuvre Catalogue and Documents, Gondolat Kiadó, Budapest, 2003
- Bíró Dávid: Gedő Ilka élete és művészete, Budapest, MEK, 2009 Le mémoire peut être consulté en ligne : https://mek.oszk.hu/07400/07415
- Bíró Dávid: Ilka Gedő - The Painter and Her Work A Background Report, Budapest, MEK, 2009 ; Le mémoire peut être consulté en ligne : https://mek.oszk.hu/07400/07416
- Bíró Dávid: Ilka Gedő : ihr Leben und ihre Kunst, Budapest, MEK, 2009 Le mémoire peut être consulté en ligne : https://mek.oszk.hu/07400/07417
Liens externes
- Ilka Gedő on Wikipedia Commons
- Artist's website
- The Complete Works of Ilka Gedő (1921-1985): Digitised Catalogue Raisonne
- Œuvres d'Ilka Gedő au British Museum
- Oeuvres d'Ilka Gedő au Metropolitan Museum
- Les œuvres sur papier d'Ilka Gedő à l'Albertina peuvent être consultées en inscrivant le nom de l'artiste dans le champ
- Les œuvres sur papier d'Ilka Gedő au Museum of Modern Art, New York
- Musée Herzog Anton Ulrich (HAUM) peuvent être consultées en inscrivant le nom de l'artiste dans le champ
- Les œuvres sur papier d'Ilka Gedő au Städel Museum, Frankfurt am Main
- Œuvres sur papier d'Ilka Gedő au Musée des Beaux-Arts de Houston
- Œuvres sur papier d'Ilka Gedő à la Albright-Knox Art Gallery, Buffalo
- Oil paintings by Ilka Gedő at the Hungarian National Gallery
- Selection of works of Ilka Gedő held by Yad Vashem Art Museum
- Dávid Bíró: Ilka Gedő - The Painter and Her Work / A Background Report, Hungarian Electronic Library, Budapest, 2014
- Dávid Bíró: Die Kunst von Ilka Gedő im Spiegel ihrer Schriften, Notizen und anderer Dokumente, Ungarische Elektronische Bibliothek, Budapest, 2020
- Dávid Bíró: The Art of Ilka Gedő as Reflected in her Writings, Notes and in Other Documents, Hungarian Electronic Library, Budapest, 2020
- Nicole Waldner: "'She Drew Obsessively' – Ilka Gedő’s Legacy Restored” Lilith, August 17, 2021
- Ressources relatives aux beaux-arts :
- Bridgeman Art Library
- (de + en) Artists of the World Online
- (en) British Museum
- (en) MutualArt
- (nl + en) RKDartists
- (en) Union List of Artist Names
- Portail de la peinture
- Portail de la Hongrie
На других языках
[de] Ilka Gedő
Ilka Gedő (* 26. Mai 1921 in Budapest; † 19. Juni 1985 ebenda) war eine bedeutende Vertreterin der ungarischen Grafikkunst und Malerei. Bis zum Jahre 1949, als sie ihre künstlerische Laufbahn vorläufig beendete, schuf sie ein sehr umfangreiches Grafikwerk[1], das verschiedene Serien von Zeichnungen („Selbstporträts“, „Ganz Fabrik“, „Tischserie“) umfasst. Sie interessierte sich für kunstphilosophische und kunstgeschichtliche Fragen und fertigte Übersetzungen aus Goethes Farbenlehre an. Nach einer Unterbrechung von anderthalb Jahrzehnten setzte sie ihre Laufbahn im Jahre 1964 fort. 1969/1970 verbrachte sie ein Jahr in Paris. In den zwei Schaffensperioden sind 152 Gemälde und eine sehr große Zahl von Zeichnungen entstanden.[en] Ilka Gedő
Ilka Gedő (May 26, 1921 – June 19, 1985) was a Hungarian painter and graphic artist. Her work survives decades of persecution and repression, first by the semi-fascist regime of the 1930s and 1940s and then, after a brief interval of relative freedom between 1945 and 1949, by the communist regime of the 1950s to 1989. In the first stage of her career, which came to an end in 1949, she created a huge number of drawings[1] that can be divided into various series. From 1964 on, she resumed her artistic activities creating oil paintings. "Ilka Gedő is one of the solitary masters of Hungarian art. She is bound to neither the avant-garde nor traditional trends. Her matchless creative method makes it impossible to compare her with other artists."[2][es] Ilka Gedő
Ilka Gedő (26 de mayo de 1921 - 19 de junio de 1985) fue una pintora y artista gráfica húngara.- [fr] Ilka Gedő
[it] Ilka Gedő
Ilka Gedő (Budapest, 26 maggio 1921 – Budapest, 19 giugno 1985) è stata una pittrice e disegnatrice ungherese. La sua opera è sopravvissuta a decenni di persecuzione e repressione, prima da parte del regime filofascista degli anni '30 e '40 e poi, dopo un breve intervallo di relativa libertà tra il 1945 e il 1949, dal regime comunista dagli anni '50 al 1989. Nella prima fase della sua carriera produsse numerosi disegni che possono essere suddivisi in varie serie.[1] Dal 1964 in poi riprese la sua attività artistica creando dipinti ad olio. Considerata un'artista indipendente, non è legata né all'avanguardia né alle tendenze tradizionali.[2][ru] Гедё, Илка
Илка Гедё (венг. Gedő Ilka; 26 мая 1921 г. — 19 июня 1985 г.) — венгерский живописец и график. Ее работы пережили десятилетия преследований и репрессий, сначала со стороны полуфашистского режима 1930-х и 1940-х годов, а затем, после короткого промежутка относительной свободы между 1945 и 1949 годами, со стороны коммунистического режима 1950-х — 1989 годов. На первом этапе своей карьеры, который завершился в 1949 году, она создала огромное количество рисунков, которые можно разделить на различные серии.[3] С 1964 года она возобновила свою художественную деятельность, создавая картины маслом. «Илка Геде является одним из одиноких мастеров венгерского искусства. Она не связана ни с авангардом, ни с традиционными тенденциями. Ее бесподобный творческий метод не позволяет сравнивать ее с другими художниками.»[4]Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.
WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии